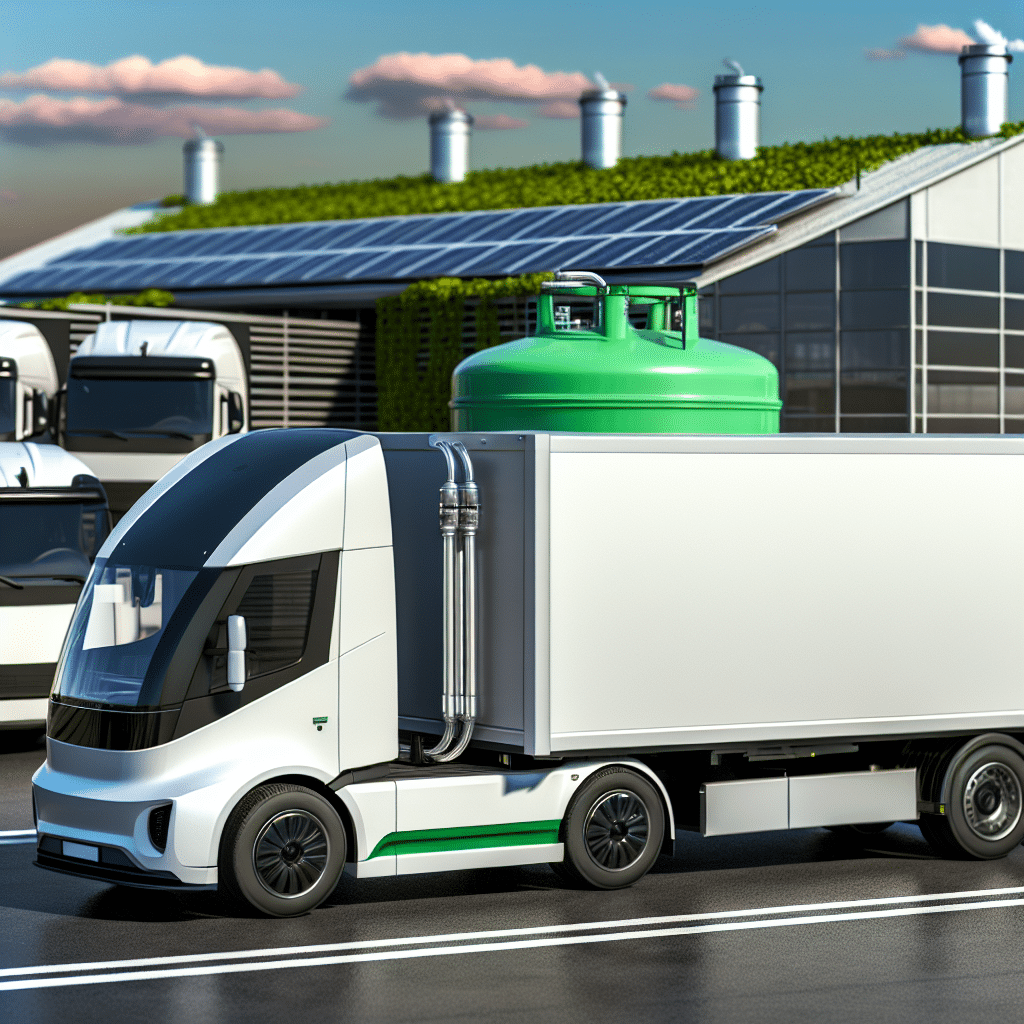La décarbonation du transport et de la logistique n’est plus une option, mais un impératif. Confrontés à une urgence climatique de plus en plus pressante et à des régulations environnementales qui se généralisent, les acteurs du secteur doivent entièrement repenser leurs pratiques. Zones à faibles émissions, réglementations européennes ambitieuses, bouleversements post-COVID : la conjonction de ces facteurs impose une transformation rapide et profonde des modèles logistiques traditionnels.
Aujourd’hui, la performance économique ne peut plus être dissociée de l’impact environnemental. De l’abandon progressif du diesel à l’exploration de nouvelles énergies comme le gaz naturel, l’électrique ou l’hydrogène, les solutions se multiplient. Mais cette transition demande bien plus que des changements technologiques : elle appelle une refonte des organisations, une exploitation intelligente des données et une collaboration renforcée entre entreprises et territoires. À l’aube d’un tournant décisif, la logistique doit désormais conjuguer efficacité et durabilité.
Transport, logistique et climat : des solutions concrètes à explorer
Face à l’urgence climatique, la logistique doit évoluer
À l’heure où l’urgence climatique ne cesse de se rappeler aux consciences, le secteur du transport et de la logistique est appelé à se transformer en profondeur. Longtemps fondées sur des logiques exclusivement économiques et de rapidité, les chaînes logistiques intègrent désormais, bon gré mal gré, des exigences environnementales croissantes.
La pression réglementaire s’intensifie : en Europe, les États et les collectivités locales multiplient les restrictions d’accès à la voirie en fonction des émissions de polluants issues des véhicules. En France, cela se traduit notamment par l’extension rapide des Zones à faibles émissions : une contrainte réglementaire croissante pour la logistique urbaine. Ces ZFE, imposant des normes minimales sur les motorisations autorisées à circuler dans les centres urbains, sont aujourd’hui implantées dans une douzaine d’agglomérations françaises, et devraient s’étendre à la majorité des métropoles d’ici à 2025.
Parallèlement à cette régulation de l’espace routier, la pandémie de COVID-19 a accéléré la révision des modèles logistiques traditionnels. Elle a mis en lumière la fragilité de certaines chaînes d’approvisionnement, tout en rendant incontournables de nouvelles contraintes sanitaires (distanciation sociale, livraison sans contact, réduction des interactions humaines). Résultat, les acteurs du secteur doivent aujourd’hui composer avec des préoccupations multiples : efficacité opérationnelle, résilience face aux crises, mais aussi réduction de leur empreinte carbone.
L’enjeu est donc central : comment maintenir la fluidité, la ponctualité et la rentabilité des livraisons dans un contexte où les objectifs climatiques imposent des transformations rapides et parfois coûteuses ? La performance économique ne peut plus se concevoir sans tenir compte des enjeux environnementaux, et cette transition oblige déjà entreprises, collectivités et transporteurs à repenser leurs outils, leurs modes de livraison et leur organisation logistique globale.
Faut-il condamner le moteur thermique dans la logistique ?
Symboles du transport traditionnel, les moteurs thermiques sont aujourd’hui dans le collimateur des politiques climatiques. Dans le viseur : le diesel, encore largement dominant dans les flottes logistiques, en raison de sa puissance, de son autonomie et de son coût à l’usage. Mais ses effets sur la qualité de l’air (émissions de CO₂, particules fines) en font une cible prioritaire pour les pouvoirs publics.
Les normes européennes successives (comme Euro VI) ont déjà permis de réduire les émissions polluantes des poids lourds neufs. Mais l’objectif fixé par le paquet réglementaire Fit for 55, qui vise une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990, pousse à accélérer la décarbonation du secteur. Certains pays et métropoles vont même plus loin : d’ores et déjà, plusieurs villes européennes annoncent la fin des véhicules thermiques dans leurs centres pour les années 2030 à 2040.
Dans ce cadre, condamner totalement le moteur thermique à court terme paraît irréaliste compte tenu des défis techniques et économiques qu’induirait une bascule immédiate vers d’autres technologies. Mais son avenir est clairement compté. La logistique du futur s’écrira, à terme, sans diesel, et demandera des alternatives viables pour continuer à livrer vite, loin, et proprement.
Gaz, électricité, hydrogène : les énergies de demain pour un fret plus propre
Le gaz naturel, une énergie pivot en phase de transition
Alors que les transports logistiques sont sous pression pour réduire leur impact carbone, le gaz naturel pour véhicules (GNV) apparaît comme une solution de transition crédible. Déjà opérationnel, ce carburant alternatif bénéficie d’une technologie mature et d’un usage croissant dans les flottes de poids lourds.
Le bioGNV, produit à partir de déchets organiques, permet une réduction des émissions de CO₂ allant jusqu’à 80 % par rapport au diesel, selon les données de l’ADEME. Même le GNV fossile, moins vertueux, affiche une baisse de 15 à 20 % des émissions, ce qui en fait une alternative pragmatique dans l’attente de technologies plus avancées.
Malgré ces avantages, la maturité du GNV est freinée par un maillage inégal des stations de ravitaillement à travers le territoire. Certaines régions restent peu couvertes, limitant la faisabilité de trajets longs sans réapprovisionnement. Toutefois, les grandes agglomérations et les zones logistiques commencent à s’équiper à un rythme soutenu.
Les acteurs mondiaux de la distribution et certains transporteurs anticipent cette évolution. Des flottes GNV font progressivement leur apparition dans la grande distribution et la livraison urbaine, avec une rentabilité améliorée grâce aux aides fiscales et à la durabilité opérationnelle du carburant.
L’électrique marque des points, surtout en milieu urbain
Si l’électrification du transport longue distance demeure complexe, les véhicules électriques s’imposent comme une solution déjà très performante dans les centres urbains. Adaptés aux “derniers kilomètres”, ces utilitaires allient silence, performance et respect des normes locales de pollution.
Le développement de camions électriques pour la livraison en ville s’accélère, porté par les restrictions d’accès aux centres urbains et une demande croissante en livraisons e-commerce. Les géants de la logistique intègrent des modèles zéro émission pour contourner les régulations croissantes sur la qualité de l’air.
Néanmoins, le secteur est confronté à plusieurs défis : autonomie réduite des véhicules, prix d’acquisition élevé, temps de recharge important et dépendance à des réseaux électriques adaptés. Les initiatives publiques visent à densifier les infrastructures de recharge rapide, mais les disparités régionales ralentissent une adoption homogène.
À l’horizon, l’innovation joue un rôle moteur. De nouvelles générations de batteries promettent une autonomie étendue, et les constructeurs développent des solutions hybrides modulables. Comme le montre le ferroutage, une alternative durable face au tout-routier en France, la combinaison des modes de transport et des motorisations pourrait permettre une transition fluide vers une logistique zéro carbone.
L’hydrogène vert séduit, mais reste un pari sur l’avenir
Parmi les énergies émergentes, l’hydrogène vert attire une attention particulière en tant que carburant d’avenir pour le transport de marchandises longue distance. Cette technologie offre une promesse séduisante : une mobilité sans émission directe, un plein rapide et une autonomie équivalente à celle des poids lourds thermiques actuels.
Grâce au soutien de nombreuses initiatives publiques, notamment en France et au sein de l’Union européenne, des projets industriels pilotes voient le jour. L’ambition est claire : faire de l’hydrogène une brique essentielle de la transition énergétique logistique. Des consortiums se forment autour de la production d’hydrogène par électrolyse alimentée en énergies renouvelables, et de la création de corridors de transport dotés de stations à hydrogène.
Malgré cet engouement, les obstacles restent nombreux. Le coût de production de l’hydrogène vert est encore élevé, rendant l’option peu compétitive sans subventions. De plus, les infrastructures de distribution sont aujourd’hui quasi inexistantes à l’échelle nationale. Côté technologique, les camions à pile à combustible sont encore en phase de test sur le terrain.
Selon France Hydrogène, le cap de la maturité commerciale ne sera franchi qu’entre 2030 et 2040, même si des démonstrateurs circulent déjà sur certaines lignes pilotes. En attendant, les acteurs du fret devront concilier stratégie court terme avec GNV ou électricité, et vision long terme portée par l’hydrogène.
Comment réorganiser la chaîne logistique pour la rendre durable ?
Repenser les flux et mutualiser les ressources
Face à la pression environnementale croissante, améliorer les performances écologiques de la logistique passe avant tout par une révision profonde des flux de transport et de distribution. L’optimisation des plans de tournées, la massification des envois et la mutualisation des moyens logistiques entre plusieurs acteurs permettent de réduire significativement les kilomètres parcourus à vide et, par conséquent, les émissions inutiles de CO₂.
Dans les zones industrielles ou les plateformes multimodales, certaines entreprises s’unissent pour mutualiser entrepôts, docks de chargement, voire flottes de véhicules. Ces synergies logistiques permettent non seulement de limiter l’impact environnemental, mais aussi de réaliser des économies d’échelle. Des outils numériques de planification, allant jusqu’à l’intégration de l’intelligence artificielle, permettent désormais d’anticiper les volumes, d’adapter les ressources et de modéliser les scénarios de transport en temps réel.
Dans cette perspective, exploiter le Big Data pour optimiser la chaîne logistique et réduire les impacts environnementaux devient une condition clé de réussite. L’analyse en continu des données permet d’identifier les points de congestion, de prévoir les niveaux de demande et d’orchestrer plus finement tous les flux logistiques.
Intégrer des indicateurs environnementaux à la performance supply chain
Les gestionnaires de la supply chain doivent aujourd’hui répondre à de nouveaux critères de performance, qui ne se limitent plus aux seules contraintes de coût ou de délais. Intégrer des indicateurs environnementaux devient indispensable pour mesurer avec précision l’empreinte carbone, les nuisances sonores ou les émissions de particules générées par chaque maillon logistique.
Des plateformes spécialisées, comme TK’BLUE, permettent d’objectiver ces paramètres en fournissant aux entreprises des tableaux de bord de leur impact environnemental. Ces outils valorisent les bonnes pratiques, facilitent la prise de décision écoresponsable et favorisent les relations avec des partenaires partageant les mêmes engagements.
De plus, les donneurs d’ordres ont un rôle structurant : en intégrant des critères verdis dans leurs appels d’offre logistique, ils incitent leurs prestataires à décarboner progressivement leurs opérations. L’impact est alors systémique, influant sur l’ensemble du tissu économique lié à la chaîne d’approvisionnement.
Retour d’expérience d’industriels : Pepsico face au défi logistique
Chez Pepsico, la transition vers une logistique durable ne relève plus du projet isolé, mais bien d’une stratégie globale intégrée à toutes les étapes de la chaîne. Jean-Paul Guichard, directeur Supply Chain France, évoque une approche structurée qui va de l’utilisation de flottes alternatives à la reconfiguration des entrepôts.
La marque collabore avec des transporteurs équipés de véhicules au gaz naturel et au bioGNV, ainsi que des camions électriques pour les trajets de livraison urbaine. Cette transition énergétique cible une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre, tout en maintenant une exigence de qualité sur les délais.
Par ailleurs, une attention particulière est portée à la prévision des ventes et à la gestion intelligente des stocks. En évitant les ruptures comme les surplus, Pepsico parvient à limiter fortement les trajets inutiles et les flux logistiques correctifs, souvent coûteux et énergivores.
Ces retours de terrain montrent que des solutions concrètes existent, à condition d’articuler innovation technologique, monitoring environnemental et collaboration entre acteurs privés et publics. La logistique verte ne se décrète pas : elle se structure, se planifie et s’évalue avec rigueur.
La transition écologique du transport et de la logistique est en marche, stimulée par une combinaison de contraintes réglementaires, de pressions sociétales et d’innovations technologiques. Si aucune solution unique ne s’impose à l’ensemble du secteur, les alternatives comme le GNV, l’électricité ou l’hydrogène montrent que des voies concrètes existent. Mais la réussite de cette mutation repose autant sur le choix des motorisations que sur la réorganisation intelligente des chaînes logistiques. Les industriels engagés démontrent que sobriété carbone et performance peuvent coexister. À condition d’anticiper, de coopérer et d’intégrer durablement les enjeux climatiques au cœur des modèles économiques.